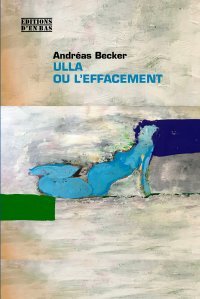

Claro – Le Monde, 08.06.2019
Nicolas Gary, Actualitté, 07.05.2019
SDLGENEVE19 – En marge du salon du livre, les Éditions d’En-bas, originaire de Lausanne présentaient le dernier livre d’Andréas Becker, Ulla ou l'effacement. Un titre pour lequel est également lancée une souscription,
aboutissant à un livre enrichi de photos tirées du film Bleu Pâlebourg, de
Jean-Denis Bonan.
Ulla ou l’effacement, c’est l’histoire d’une mère,
emportée par l’alcool, mais également des bombardements sur Hambourg. Une allusion à l’Opération Gomorrhe, campagne ayant abouti à sept raids aériens sur la ville allemande, entre le 25
juillet et le 3 août 1943. Un carnage qui fit pas moins de 45.000 morts, resté dans les annales de l’histoire comme l’attaque la plus dévastatrice en Europe.
Lentement, une femme s’efface devant le monde. Autour d’elle, les silences, les absences, une clarté presque insoutenable, les paysages vides du Nord de l’Allemagne. Elle s’allonge sur un canapé, chez elle, dans son salon ; seuls l’alcool et les médicaments la font encore bouger. Le médecin est formel, la mort approche par cirrhose du foie.
Andréas Becker accompagne la malade d’une langue ciselée et tendre, d’une langue qui cherche constamment à dire ce qui est encore exprimable quand la vie s’en va, mais quand l’amour se tisse. Malgré la tristesse de la mort se crée ainsi une espérance dans ce qui restera et que Becker nomme alors ça. Ça, c’est Ulla.
Le livre, à paraître ce 14 mai, s’accompagne donc d’une
édition de tête, augmentée d’images de Jean-Denis Bonan, hors commerce, qui sera disponible uniquement en souscription. Les 40 premiers exemplaires
de cette édition seront dédicacés par l’auteur et le réalisateur, numérotés et accompagnés d’un tirage original ainsi qu’une reproduction d’un extrait du manuscrit. Il faudra compter 40 €
pour le tirage augmenté et 100 € pour l’édition spéciale.
Une projection du film est prévue en avant-première, ce 26 mai
à 11 h 30 au cinéma Saint-André des Arts, en présence de Jean-Denis Bonan, Andréas Becker, Sophie Bourel, Jean Richard, Pascal Cottin et l’équipe du film. « Il
y a le texte de Becker, époustouflant. J’ai tenté des images à côté, comme un hors champ », indique le réalisateur.
Le film de Bonan est directement inspiré du livre d’Andreas
Becker – les deux hommes avaient d’ailleurs collaboré pour leur film La
soif et le parfum. Les Éditions d’En-bas avaient elles
republiés les trois précédents ouvrages de l’écrivain, à l’automne 2018.
[à paraître 14/05] Andreas Becker – Ulla ou l'effacement -
Éditions d’En-bas – 9782829005893 – 8 €
Frédéric Fiolof – remue.net, 23.04.2019
Ulla ou l’effacement, d’Andréas Becker
Ulla ou l’effacement,
récit d’Andréas Becker
Editions d’En Bas, avril 2019
par Frédéric Fiolof
Il y a des textes qu’il faut longtemps attendre avant de les écrire. Le dernier livre d’Andréas Becker, qui est aussi son premier récit, est sans doute de ceux-là. Il tient à peine en 55 pages, mais il distille une lumière noire qui, pour les lecteurs qui suivent cet écrivain depuis son premier roman, donne l’impression d’avoir longtemps nourri son œuvre. Une œuvre où se pressent depuis toujours des vies blessées, déchirées, violentées dont on a souvent le sentiment, et qu’importe leur dimension fictionnelle, qu’elles ont été accueillies bien plus qu’enfantées. Janus mi-fillette, mi-vieillard régurgitant les abominations de l’histoire dans L’Effrayable, narratrice qu’étrangle son passé dans Les Nébuleuses, légataire d’une mort inacceptable qu’il a lui-même provoquée dans Les Invécus, mosaïque de visages et de destins brisés dans Gueules : autant de figures démantibulées, d’existences anonymes marquées par le désastre ou son souvenir, et qui, portées par la langue si singulière de Becker, ou soumises à ses façons de faire voler en éclat les cadres spatio-temporels, nous donnaient pourtant à toucher du doigt toute l’aberration du réel. Tant et si bien que dans cette « sortie de la fiction » qu’entreprend Ulla ou l’effacement, Andréas Becker nous plonge au cœur d’une réalité à laquelle, pourrait-on dire, il nous avait préparés, dont il avait déployé l’horreur par d’autres voies et d’autres boursouflures.
Dans ce texte court et saisissant, l’auteur revient sur les derniers jours et la mort de sa mère, emportée par une cirrhose à l’âge de 46 ans. Un espace-temps circonscrit qui rappelle parfois à lui quelques pans de mémoire, pièces rapportées d’une existence faite avant tout de longues plages de silence. Mais ce tombeau poignant que dresse l’auteur prend aussi une dimension collective qui s’enracine dans les décombres de la guerre. Car au cœur de ce silence maternel et de cette vie dévastée par l’alcool, il y a la plaie encore à vif des grands bombardements conduits sur l’Allemagne nazie dans les années 40. La population civile de Hambourg (ville natale de Becker et de sa mère) paya alors un lourd tribut : 45.000 morts en moins de deux semaines durant l’été 1943. L’un des raids aériens les plus meurtriers de toute la seconde Guerre Mondiale. Avoir été enfant à Hambourg en 1943, c’est, au mieux, avoir survécu et grandi dans le sillon d’un double traumatisme : celui de l’horreur vécue en direct (à l’instar de ces scènes insoutenables qui hantent la mémoire d’Ulla) ; et celui du silence : les civils de l’Allemagne d’après-guerre appartenaient à la classe des vaincus, des punis, de ceux qui, à l’aune des crimes du Troisième Reich, n’avaient pas le droit de se plaindre. Une parole ravalée qui s’estompera dans l’alcool sans jamais s’y dissoudre, pour Ulla comme pour bien des femmes et des hommes de cette génération et de cette ville là.
Mais cet arrière-fond omniprésent imprègne le texte de Becker sans pour autant l’infléchir vers un récit historique. Il cherche au contraire à faire corps avec son personnage, tournant sans cesse autour du vide qui l’habite dans une tension presque beckettienne. Car ce retour au pays natal sur les traces de la mère nous immerge dans l’épaisseur d’un silence qui n’en finit pas de se débattre avec lui-même. Exercice un peu à contre-emploi des longs monologues explosifs et déstructurés auxquels nous avaient habitués les romans de l’auteur, Ulla ou l’effacement endosse une autre peau, revêt une forme plus minimaliste. La solitude et le malheur ne se délitent plus ici dans une parole surabondante mais se tiennent au plus près de l’os irréductible qui leur est donné à ronger. Andréas Becker s’efforce de redonner chair à un manque sans jamais tenter de le résorber. Il se tient au plus près de ce qui a fait défaut et instaure une manière de relation à la fois intime et fragile à ce vide. La langue, moins débridée que dans d’autres textes de l’auteur, garde pourtant la marque d’une discrète étrangeté. Une langue faussement orale, tremblée, qui se reprend, s’enroule autour d’elle-même et semble parfois au bord de se briser. Alors, derrière les mots, il ne reste plus que la grisaille du Nord (Hambourg, rebaptisée Pâlebourg), la crudité d’un corps dans sa mouvante destruction, et les quelques souvenirs qui trompent à peine cette vie rivée au silence. Une vie de peu, à laquelle Andréas Becker rend ici un hommage fort et émouvant.
Frédéric Fiolof dirige la revue littéraire La moitié du fourbi qu’il a créée en 2015. Il a participé quelque temps à La Nouvelle Quinzaine littéraire et publié un roman, La Magie dans les Villes, chez Quidam éditeur en 2016. Un récit paraîtra chez ce même éditeur début 2020.
Charybde 27, le Blog, Robert Hugues, 27.04.2019
De l’agonie silencieuse d’une femme et d’une mère, extraire une signification puissante et une tendresse subtile.
x

Elle, elle était allongée sur le canapé, sur le dos, une main sur son
ventre bombé d’eau. C’était ça, elle, là. Elle n’était rien d’autre que ça, là, le canapé contre un mur blanc, un mur vide. C’était dans les vapes qu’elle était. Quelque part là, oui, sans doute.
Il faudrait dire ça plus exact peut-être, mais on ne peut pas. Ce qu’on ne peut pas, il faudrait l’essayer ici.
Le canapé était bouteille vert, ça je me souviens.
Ça ne disait rien, elle.
À Hambourg, que l’on appellera ici – et on en comprendra en temps utile la raison – Pâleville, une femme se meurt. Enfermée depuis – sans doute – déjà longtemps dans un alcoolisme devenu chronique, elle voit – à peine, peut-être – la vie couler autour d’elle, observatrice muette, depuis son canapé, observatrice dont on serait bien en peine de définir le degré exact d’attention portée au monde environnant, alors même que ses organes malmenés déposent désormais les armes les uns après les autres – sauf le cœur, solide comme un roc, qui, lui, ne se rend pas.
Elle avait vu le médecin, lui avait dit l’eau dans le ventre, l’eau dans
les jambes, le lui avait dit, la bouteille de whisky par jour. C’était ça, depuis des années. Maintenant, ça, elle n’en avait plus besoin, c’était condamné. Le foie, c’était irréversible, le
ventre bombé, les varices, les hématomes, les saignements. Les reins foutus, les artères bouchées.
Le cœur est bon, c’est ça le drame. Ç’avait dit ça, le médecin. Ça
faisait lui rester trois mois. Jusqu’à Noël. Elle, ça elle ne savait pas que ça lui faisait rester trois mois, c’était pas ça qu’avait de l’importance. Autour d’elle, l’important il n’y en avait
plus. C’était pas non plus qu’on puisse dire qu’elle attendait. Non, c’était autre chose. C’était autre chose comme rien. Mais elle, ce qu’on ne peut pas dire d’elle c’est que c’était rien. Elle
était là encore comme pas là, mais elle était là. C’était elle encore comme d’un corps. Il y avait ça encore en elle qu’on ne sait nommer autrement que ça.
Mais de ça, elle ne manifestait rien. Elle écoutait quand on lui parlait.
On lui disait de se lever. Ça il faudrait se le dire toujours, on lui disait de se lever. C’est ça, oui, qu’elle écoutait. Elle ne se levait pas. Elle n’avait pour ce qu’elle écoutait qu’un
sourire. Elle, ce qu’elle faisait qu’elle se levait quand elle était seule, c’était la bouteille de whisky. Elle la cachait entre les casseroles. Elle se mettait à genoux, elle buvait une gorgée,
elle se couchait. Ce n’était plus qu’elle en avait besoin, c’était par presque comme de l’amour.
x

Caspar David Friedrich, Paysage avec pavillon, 1797
Comme dans « Nébuleuses » (2013), comme dans « Les invécus » (2016), Andréas Becker invente à point nommé le langage strictement nécessaire à sa narration, à son projet secret chaque fois renouvelé, à son exploration de certains confins inquiétants de l’âme humaine, de certaines zones frontalières entre ce qu’il est souvent convenu d’appeler la folie et la santé mentale, réussissant à nouveau ce miracle d’écriture qui crée régulièrement du neuf (« je n’ai jamais entendu cette langue-là ») tout en s’inscrivant dans une sauvage continuité (« je suis bien en train de lire du Andréas Becker« ).
C’est ça qu’il faudrait dire faux avec des mots fautifs. C’était autour
d’elle cette belle lumière du Nord, cette lumière fautive. C’était le pavillon, le salon, la baie vitrée et le jardin, c’était ça, fautif. Il y a sa vie comme une vie fautive, une vie comme pas
vécue, une vie pour rien, qui se termine là, dans un souffle, sans effort, c’est là, sa vie comme un malentendu. C’était faux, elle, là, faux comme corps. C’était faux comme ce corps qui allait
finissant sans avoir fleuri.
Ce n’est pas qu’elle perdait connaissance, elle n’en avait plus vraiment.
Elle allait de plus en plus rarement à la bouteille. Elle oubliait les pilules. Elle oubliait qu’elle voulait se tuer avec l’alcool et les pilules, elle n’a jamais voulu se tuer, c’est faux, ça
aussi. Mais elle voulait tuer ses organes, un à un, les reins, le foie, la rate, les poumons, finalement le coeur. C’était ça, comme un plan établi. Elle voulait, par là, tuer le monde. Tuer ses
enfants, tuer son mari, tuer son amant, venger son monde. Elle était là, sur le canapé, la vengeresse terrible d’un monde qui n’avait pas voulu d’elle. Elle était la vengeresse souriante, celle
qui ne vous oublie pas.
x

Comme dans « L’effrayable » (2012), et de manière paradoxalement peut-être encore plus directe, il y a ici un compte qui doit se régler avec une certaine Allemagne, une double Allemagne qui s’incarne dans des figures distinctes, utilisant les interstices silencieux du discours principal – double Allemagne qui se nourrit ici essentiellement de mots et de symboles, ceux de la langue du IIIème Reich traquée par Victor Klemperer, qu’Andréas Becker évoque par la percutante formule « C’était qu’on avait eu des mots nazis la raison pour laquelle on ne parlait plus », ceux de la langue du miracle économique et de son impavidité, mises en scène dès l’origine par l’Heinrich Böll de « Es wird etwas geschehen » (mais dont les traces perdureront jusque dans, par exemple, le beaucoup plus tardif « Protection encombrante »), ou, de manière beaucoup plus contemporaine, par l’Alban Lefranc de « Si les bouches se ferment », langue pour laquelle c’est une véritable forêt de signes qui est discrètement mobilisée.
À Pâlebourg on mourait toujours seul. Pâlebourg, la mort ça ne s’y disait
pas, pas dans une ville qui avait connu des milliers de cadavres en quelques heures de bombardement. Pâlebourg, ça vivait de son port, de ses putes, de ses banques et assurances. De ça, on était
fiers jusqu’à l’écoeurement. C’était qu’on avait reconstruit une ville comme un quartier d’affaires. Les immeubles portaient leurs façades clinquantes comme des forteresses, des larges
autoroutes urbaines permettaient le drainage en voitures. Il y avait des ascenseurs et des trahisons de bureau, il y avait là, comme des carrières de l’argent et du pouvoir. C’était ça
qu’on appelait une ville.
Autour, dans les faubourgs sans nom, ronronnaient les femmes. C’était
dans ces campagnes vides que se déroulaient leurs vies vides. Les plus courageuses d’entre elles mouraient d’alcool. C’était des morts lentes, atroces qui se produisaient là, entre les
caisses des supermarchés et à la sortie de l’école. Pour que ça meure propre, on avait dressé des haies autour des jardins. La pluie battante c’était ça comme des rideaux devant les fenêtres,
sinon on les bouchait avec des plantes vertes. La vue, c’était ça qu’on ne voulait pas voir, surtout pas, comme les mots qu’il ne fallait pas prononcer, les sentiments qu’il ne fallait pas avoir.
Les sentiments, c’était ça qui était remplacé par les briques rouges des pavillons, c’était les briques rouges qui contenaient les morts.
x

Traumatismes originels, quasiment fondateurs, d’une gamine de six ans en 1945 (le Kurt Vonnegut d’ « Abattoir 5 » n’est peut-être pas si loin), résignations plutôt morbides d’une femme de trente ans (par lesquelles les paysages du Schleswig-Holstein, sous-jacents, se mettent à résonner avec ceux de Flandre orientale, en un Nord presque mythologique qui deviendrait aussi celui des « Flamandes » de Jacques Brel) : la colère, très présente, est ici plus assourdie que dans « L’effrayable », la gouaille spéculative de « Nébuleuses » ou même des « Invécus » n’a pas été réellement invitée à la fête macabre, mais dans ce destin d’une femme allemande, figé, immobile, où la part autobiographique prétend s’avouer, pour la première fois chez l’auteur (« Elle s’appelait Ulla. Je m’appelle Andréas. »), une tendresse brutale, paradoxale et authentique, semble comme sourdre des pierres pavillonnaires assemblées pour l’occasion. Incarnation silencieuse de villes détruites et de vies foudroyées, « Ulla ou l’effacement », publié en 2019 aux éditions d’En Bas (qui, rappelons-le, ont réédité l’automne dernier les trois premiers romans de l’auteur, sous de somptueuses couvertures signées Jean-Denis Bonan), constitue une étape décisive, poignante et poétique, intelligente et mystérieuse, en cinquante pages, dans l’œuvre passionnante d’Andréas Becker.
x

Photo ® Monique Calinon
Le blog de Francis Richard, 05.06.2019
Elle, elle était allongée sur le canapé, sur le dos, une main sur son ventre bombé d'eau. C'était ça, elle, là. Elle n'était rien d'autre que ça, là, le canapé contre un mur blanc, un mur vide.
C'est ainsi que commence Ulla ou l'effacement. Ce début met tout de suite dans l'ambiance recréée par Andréas Becker. Car il est difficile de penser qu'il ne s'agit pas de quelque chose de vécu.
Pour parler d'elle, Ulla, née en 1939 à Pâlebourg, il emploie le mot ça. Mais ce mot n'a rien de méprisant. Le lecteur comprend, par ce mot, qu'un être humain est réduit là à une pauvre petite chose.
Les mots sont impuissants à rendre compte de ce qu'est devenue cette femme, amaigrie, grabataire. Elle est en effet sur un lit d'hôpital, puis elle est chez elle allongée sur un canapé bouteille vert.
Elle se déplace seulement à la cuisine pour, à genoux, y boire du whisky: avec les whiskies elle avait encore des pilules qu'elle avalait désordre, des cigarettes, des photos-romans, ce pour tout inventaire.
Elle a quarante-six ans et cela fait quatre ans qu'elle est dans cet état-là. Si elle est encore là, de ce monde, c'est que le coeur est bon, c'est ça le drame. C'est du moins ce qu'en a dit le médecin perdu.
A un moment, le lecteur apprend de quel mal ce qui l'emporte est le nom: C'est une mort lente, atroce, c'est une mort qui arrive par vagues, qui relâche par instants pour mieux reprendre sa proie.
La fin de cette histoire est prévisible, même si c'est long un corps si jeune à tuer. Ulla ne peut que s'effacer. Encore faut-il qu'elle le veuille. Alors, quand elle le voudra, elle sera immensément libre.
Elle ne savait pas, et ne saurait jamais, que, sans la juger, quelqu'un écrirait un jour sur sa mort lente vers laquelle elle irait en dansant, pas trop sérieuse: La mort, elle ne l'était pas non plus, sérieuse.
Francis Richard
Ulla ou l'effacement, Andréas Becker, 60 pages, éditions d'en bas
Jean-Paul Gavard-Perret, Fattorius, 21.07.2019
Ulla, alcoolisme et effacement
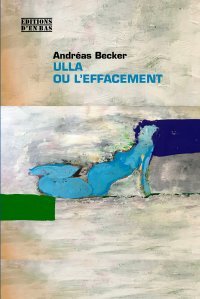
Le blog de guy, 02.11.2019
Ulla ou l’effacement. Andréas Becker.
Le canapé était bouteille vert, ça je me souviens.
Ça ne disait rien, elle. »
Le cœur est bon, c’est ça le drame. Ç’avait dit ça, le médecin. »
Addict culture, 31.01.2020
« Ulla ou l’effacement » d’Andréas Becker et Jean-Denis Bonan, hommage à l’éternelle absente »
Avec Ulla ou l’effacement, l’écrivain d’origine allemande Andréas Becker rend un hommage douloureux et poignant à sa mère Ulla, morte à 46 ans d’une cirrhose du foie. Ulla, qui a passé les dernières années de sa vie sur ce canapé « bouteille vert », dans cet appartement de Hambourg, ville martyre, bombardée, réduite en cendres pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ville où la petite fille Ulla a déambulé, couru, entourée de décombres, de blessés et de morts, ville grise. Petite fille détruite, réduite en cendres qui, elle, contrairement à sa ville, ne se reconstruira jamais. Andréas Becker écrit en français : une langue qu’il s’approprie, empoigne, malaxe jusqu’à lui faire rendre gorge.
Ulla habite une maison des faubourgs bourgeois, avec de grandes fenêtres, une belle lumière. Elle y habite, elle n’y vit pas. Cette femme-là n’a jamais vécu, elle a passé sa vie à se faire mourir à grands coups de whisky. L’air de ne pas y toucher, elle écoute ce qu’on lui dit, sourit un peu mais ne bouge pas. Quand elle est seule, elle reste couchée sur son canapé bouteille vert, se lève pour avaler une gorgée de whisky, se recouche. Le whisky, « son photo-roman à elle seule ». Le foie malade, le gros ventre, la douleur, les varices… et le cœur qui, contre toute attente, tient bon.
« Le fils, celui qu’elle a essayé d’aimer, celui qui écrit l’histoire, la regarde, se souvient, les mots sont inutiles, inadéquats. C’est quand elle sera partie, Ulla, qu’ils viendront, ces mots. Ceux que nous sommes en train de lire et qui nous émeuvent, nous, les étrangers à cette histoire. »
Le fils, celui qu’elle a essayé d’aimer, celui qui écrit l’histoire, la regarde, se souvient, les mots sont inutiles, inadéquats. C’est quand elle sera partie, Ulla, qu’ils viendront, ces mots. Ceux que nous sommes en train de lire et qui nous émeuvent, nous, les étrangers à cette histoire. Nous qui avons eu nos deuils, nos pertes et nos souffrances, mais jamais comme ça, comme Andréas Becker les écrit, les met à vif avec un mélange de brutalité et de sensibilité à fleur de peau. Ulla aura traversé sa courte vie et celle de ses proches comme un fantôme, un être éthéré dans un corps souffrant, déformé. Ou peut-être un être acharné à sa propre disparition dans un monde qui ne vaut pas qu’on y vive? Comment le fils peut-il faire face à cette disparition progressive ? Avec ses mots, avec sa peine, sa colère, son impuissance : c’est le précieux cadeau qu’Andréas Becker nous fait avec ce livre. Attraper les mots à bras le corps, les jeter sur le papier, leur donner toute la puissance de ce geste en les bousculant, en les faisant glisser, déraper, exploser et ainsi, rendre toute sa beauté à Ulla disparue.
Cette édition reliée de Ulla ou l’effacement est illustrée par des photos et des créations graphiques signées Jean-Denis Bonan : paysages urbains, portuaires, superpositions, transparences, reflets, surfaces grattées, silhouettes et corps fuyants, elles jouent un corps à corps avec les mots, avec lesquels elles s’installent dans une intimité troublante de bleus et de gris.
A noter : Jean-Denis Bonan est également le réalisateur d’un film inspiré par Ulla ou l’effacement, intitulé Bleu Palebourg.
Jean-Paul Gavard- Perret – De l'art helvétique contemporain, 17.06.2019
Obéissant à des exigences interieures mais aussi "de terrain", Andreas Becker fait de la littérature moins une affaire de livre que de fable là où la violence du propos s'oppose à une certaine "mollesse" de son personnage. Pour se dire, la langue se tord dans les corps déformés.
C'était le cas déjà avec "L'effroyable", "Nébuleuses" et "Gueules". C'est encore plus le cas avec "Ulla ou l'effacement". Un effacement paradoxal. Car le corps de la mère échoppe enflé et au bord de l'existence sur un canapé.
Cette mère n'indigne pas le fils ; il expose son corps loin de tout puritanisme ou confort. Obèse de ses renoncements la mère finit de se détruire. Le narrateur la décrit sans chercher à la mépriser ni à la purifier. Dans ses scansions il note cette déchéance là depuis toujours ; "au début et à la fin il y avait le fin, et après ça, ça était même pas le vide".
La mère continue de "se digérer", déchirée par les affres de son existence. Sur le "canapé vert bouteille" elle se liquéfie au nom des disparus qu'elle va rejoindre dans son agonie. Et Becker dit à la fois la chair mais aussi l'aura d'un corps dont les mots matières retiennent l'émotion .Celle d'une femme épuisée et qu'il tente de repriser.
Jean-Paul Gavard-Perrret
Radio fidélité, 28.01.2020
Chute libre : Entretien avec Andréas Becker
Une émission de poésie animée par Paul de Brancion entretien avec Andréas Becker
Ecrivain français d’origine allemande. Né en 1962 à Hambourg, il vit et travaille à Paris
à l’occasion de la sortie de “Ulla ou l’Effacement ” – Récit – 2019 Editions d’en Bas
Issu d’un croisement hasardeux de deux familles, l’une bourgeoise, l’autre ouvrière, toutes deux fortement atteintes par les ravages de la seconde guerre mondiale, Becker grandit dans un milieu protégé. L’école publique joue un rôle primordial dans ses goûts pour la lecture, l’écriture, pour le théâtre et la musique, mais aussi pour les mathématiques et le sport. En 1991, il s’installe à Lyon, où il découvre, émerveillé, la langue française. Becker devient professeur d’allemand, puis traducteur de romans de gare, avant d’entamer une carrière commerciale1. Il abandonne ces activités en 2015 pour se consacrer entièrement à l’écriture.2
Andréas Becker est père adoptif de trois filles.
Un livre un jour présenté par : Adeline Alexandre, Delphine Chaume – france.tv, 20.09.2019
Radio Enghien, Joëlle Verain – Au-delà du miroir, 22.05.2019
 Andréas Becker
Andréas Becker



